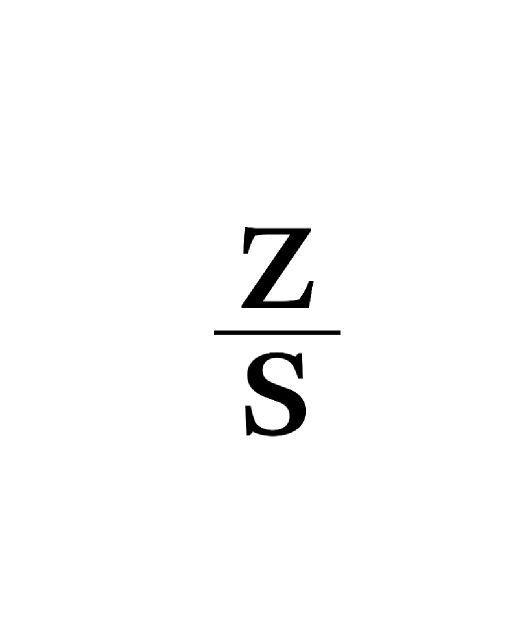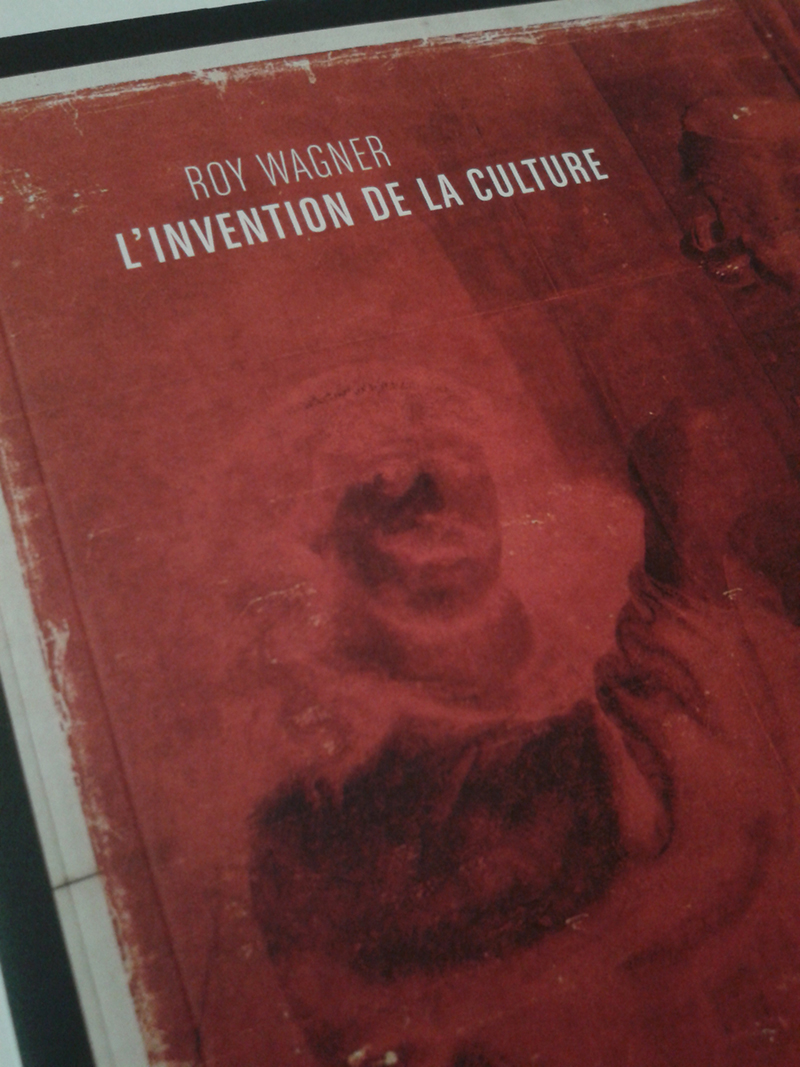ROY WAGNER
L’INVENTION DE LA CULTURE
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Philippe Blanchard. 228 p.
ISBN 978 293 060 114 4. 20 euros. Parution le 3 décembre 2014.
Initialement publié en 1975 aux États-Unis, puis réédité en 1981, L’Invention de la culture marqua un tournant décisif dans l’histoire des études anthropologiques portant sur les relations complexes entre « nature » et « culture ». Dans cet ouvrage précurseur, devenu depuis une référence incontournable, Roy Wagner s’écarte du leurre que constitue à ses yeux le « relativisme culturel » pour mieux déconstruire les fondements d’une certaine tradition pour laquelle le concept de « culture » – l’objet d’étude des ethnologues de terrain – n’avait pas à être remis en question – la culture est partout, puisque la nature est partout. À rebours des théories classiques, Roy Wagner postule que la « culture » n’est qu’une pure « invention » symbolique induite par les relations humaines, qu’il s’agisse de la magie horticole des Daribis, de la publicité dans l’Amérique contemporaine, des cérémonies du Naven, de la culture de masse ou des discours scientifique, politique et écologique. En renversant finement bien des préjugés profondément ancrés dans l’histoire de l’Occident, cet ouvrage offre aujourd’hui encore des perspectives originales pour envisager notre rapport aux « autres » et à l’environnement, car « nous vivons une époque intéressante ».
Roy Wagner est anthropologue. Il dirige le département d’anthropologie de l’université de Virginie.
Sommaire
Introduction
Chapitre 1 : La culture comme présupposé
Chapitre 2 : La culture comme créativité
Chapitre 3 : Le pouvoir de l’invention
Chapitre 4 : L’invention du moi
Chapitre 5 : L’invention de la société
Chapitre 6 : L’invention de l’anthropologie
Index
Introduction
Il y a des sciences dont le « paradigme », c’est-à-dire l’amalgame de règles et de jurisprudence théorétiques qui caractérise l’orthodoxie de ce que Thomas Kuhn appelle la « science normale », gèle tout mouvement jusqu’à ce que ses fondations se mettent à fondre sous la pression des preuves accumulées et qu’une révolution tectonique en résulte. Ce n’est pas le cas de l’anthropologie. En tant que discipline scientifique, son développement théorique a suivi un processus historique au cours duquel se sont imposées et affrontées certaines orientations, un processus dans lequel se manifeste en effet une certaine logique ou un certain ordre (voir chapitre vi). Toutefois, malgré le consensus dont il est l’objet, ce flux de production de concepts pourrait aussi être décrit comme un pur processus dialectique, comme un jeu d’exposition (et de négation) à plusieurs voix ou comme un phénomène d’accrétion éclectique. Ce qui est remarquable ici n’est pas tant la persistance de fossiles théoriques, persistance qui est le fonds de commerce de la tradition universitaire, mais l’incapacité de l’anthropologie à institutionnaliser cette persistance, voire à institutionnaliser quelque consensus que ce soit.
Si L’Invention de la culture a tendance à affirmer ses opinions, plutôt qu’à proposer des arbitrages, cela traduit, au moins en partie, l’état d’une discipline dans laquelle un auteur doit distiller sa propre tradition et susciter son propre consensus. Cela étant dit, cette tendance renvoie à certains des présupposés des trois premiers chapitres, et à la raison d’être de ce livre.
Ce qui m’intéresse en priorité, c’est d’analyser la motivation humaine à un niveau radical, plus profond que celui des clichés à la mode sur les « intérêts » corporatistes ou ceux des acteurs politiques, des classes, de « l’homme qui calcule » et ainsi de suite. Cela ne signifie pas que j’ignore béatement l’existence de tels intérêts, ni que je ne sois pas conscient de la force pratique et idéologique de l’« intérêt » dans le monde moderne. Cela signifie que j’aimerais considérer ces intérêts comme un sous-ensemble, ou une manifestation de surface, de questions plus élémentaires. Il serait donc assez naïf de s’attendre à ce qu’une étude de la constitution culturelle des phénomènes soutienne que ce processus, ou certaines de ses parties significatives, sont « déterminés » par un ensemble privilégié de phénomènes particuliers, d’autant plus qu’elle défend l’idée que le sens de ces ensembles dépend largement de leur interaction.
Tel est donc le point de vue analytique d’un livre qui choisit d’envisager les phénomènes humains d’un point de vue « extérieur », en comprenant bien qu’un point de vue extérieur est tout autant une création que les plus fiables de nos points de vue « intérieurs ». La question du relativisme culturel en est une illustration. Agissant comme une sorte de leurre pour ceux qui soutiennent l’omniprésence de la pression socio-économique ou pour ceux qui contestent la possibilité d’une objectivité scientifique véritablement non contaminée, elle semble présentée ici sous une forme idéaliste contestable. Mais voyez ce qui est fait de l’idéalisme dans la discussion qui s’ensuit, où la « culture » elle-même est présentée comme une sorte d’illusion, un faire-valoir (et une sorte de faux objectif) pour aider l’anthropologue à mettre de l’ordre dans ses expériences. Bien sûr, il est possible que la question de savoir si une fausse culture est véritablement ou faussement relative présente un quelconque intérêt pour des chercheurs véritablement pointilleux mais, globalement, on a simplement fait l’impasse sur les fondamentaux d’un vrai bon débat sur le « relativisme culturel ».
Cette tendance à faire l’impasse sur la plupart des marronniers théoriques de l’anthropologie, à les mettre de côté, à ne pas les « prendre en compte », même si elle risque fort d’être insupportable pour tous ceux qui ont quadrillé leur territoire et l’ont truffé de mines, est une conséquence de la position que j’ai adoptée. En dehors de cela, ce n’est pas l’expression d’une volonté délibérée de snober l’anthropologie ou les anthropologues ou de quémander la douteuse immunité d’une position privilégiée. En choisissant de me placer sur un terrain nouveau et différent, je n’ai fait qu’échanger un ensemble de problèmes et de paradoxes contre un autre, et ce dernier est aussi redoutable que l’ancien. Il serait utile de se livrer à un examen approfondi de ces problèmes, de même que de classer les arguments qui viennent soutenir ou contredire ma position. Mais les arguments et les preuves appartiennent à un niveau d’investigation (et, peut-être, de « science ») différent de celui auquel se situe mon entreprise.
Ce livre ne vise pas à démontrer, par les preuves, les arguments ou les exemples, un quelconque ensemble de règles ou de généralités sur la pensée et l’action humaines. Il se contente de présenter aux anthropologues un changement de point de vue, et d’esquisser ses implications sur un certain nombre de sujets de préoccupation. Si quelques-unes, voire un grand nombre d’entre elles, ne sont pas confirmées par tel ou tel groupe d’« observations », cela résulte certainement de ce que nous avons utilisé et généralisé un modèle déductif et non un modèle inductif. Il va sans dire qu’une certaine dose de circonspection est cruciale dans ce genre de modélisation et que le rapport est dans le modèle, pas dans les détails. Toutefois, le processus est au bout du compte celui qu’exprime la célèbre formule d’Isaac Newton : hypothesis non fingo. « Je n’avance pas d’hypothèses », aurait dit le fondateur – et aujourd’hui, semble-t-il, l’« inventeur » – des sciences exactes, indiquant par là qu’il écrivait ses équations et en déduisait le monde. Je voudrais ajouter que la capacité de considérer cette déclaration comme la formulation humble et sobre d’une façon de procéder, et non comme une marque de vanité, est le signe d’une capacité à adopter des points de vue « extérieurs ».
La diversité théorique de l’anthropologie ne facilite pas les généralisations critiques sur l’acquis, quelle que soit la justesse de certaines approches critiques de la tendance à théoriser. Ainsi, bien qu’il semble qu’une grande part de la théorie anthropologique, à commencer par la théorie symbolique exposée ici, n’accepte le relativisme culturel qu’à la seule fin de la transformer en quelque chose d’autre, il y a eu des approches différentes, comme celle de Franz Boas. Une fois de plus, la tendance, identifiée dans ma discussion du « musée de cire », à découvrir par analogie (et à prouver par l’expérience) des gadgets de programmation informatique et d’analyse primitive des coûts, ou de grammaire et de dogmatique de la vie sociale, bien qu’elle ne soit certainement pas universelle dans l’anthropologie moderne, reste toutefois insidieuse et dérangeante. Je reconnais que l’amalgame de différentes approches pour les critiquer a pu conduire à cet égard, et à quelques autres, à simplifier à l’excès et à négliger sans le vouloir un certain nombre de directions fructueuses et d’anthropologues prometteurs.
Un autre point qui peut frapper le lecteur comme relevant d’une médiocre stratégie, ou peut-être comme la perpétuation inconsidérée d’une erreur trop répandue, est l’opposition entre le conventionnalisme occidental et la différenciation symbolique caractéristique que préfèrent les peuples « traditionnels », ce qui englobe les sociétés « tribales », l’idéologie de civilisations complexes et stratifiées, et de certaines classes de la société civile occidentale. Comme il ressortira avec évidence de la lecture du chapitre V, cette distinction va plus loin que l’opposition simpliste entre progressistes et conservateurs, que Marshall Sahlins a parodiée à juste titre en parlant de l’« Ouest et le reste ». Ma thèse, en résumé, suggère que la différenciation des modes de symbolisation fournit le seul régime idéologique capable de gérer le changement. Les sociétés décentralisées et non hiérarchisées accueillent à la fois les dimensions collectives et individualisantes de leur dialectique culturelle dans une alternance périodique d’états ritualisés et d’états sécularisés ; les civilisations hautement développées assurent l’équilibre entre ces deux parts nécessaires de l’expression symbolique par l’interaction dialectique de classes sociales complémentaires. Dans les deux cas, ce sont des actes de différenciation tranchée et décisive – entre sacré et profane, entre propriétés de classe et privilèges – qui servent à réguler l’ensemble. Mais la société occidentale moderne, que Louis Dumont accuse de « stratification honteuse » est en déséquilibre critique : elle subit (ou célèbre) l’individuation comme son « histoire » et contrebalance le mouvement fondamentalement « collectivisant » de ses entreprises publiques par toutes sortes de stratagèmes concurrentiels plus ou moins officiels et honteux et par la farce désespérée de la publicité et du divertissement. Je soutiens que nous partageons avec l’Alexandrie hellénistique et avec les phases pré-dialectiques d’autres civilisations, une orientation transitoire et hautement instable. Toutefois, il s’agit d’une position qui s’inscrit dans un modèle et qui n’est assurément pas adoptée par commodité.
Par son inspiration et par le développement de son programme théorique, L’Invention de la culture généralise la thèse que j’ai présentée dans la monographie Habu : The Innovation of Meaning in Daribi Religion (The University of Chicago Press, 1972). Il s’agit de tenter de replacer cette thèse dans le contexte de la constitution symbolique et de la motivation des acteurs dans diverses situations culturelles. En l’espèce, cet ouvrage fonde sur l’idée centrale de Habu, selon laquelle toute symbolisation porteuse de sens enrôle les forces novatrices et expressives des tropes, ou métaphores, car même les symboles conventionnels (référentiels), que nous ne considérons pas d’ordinaire comme des métaphores, « innovent » en extension par rapport à leur signification dans d’autres champs, c’est-à-dire qu’ils sont « réflexivement motivés contre elle ». Ainsi, Habu situe la source de la signification culturelle dans des actes créatifs d’innovation, accumulant métaphore sur métaphore et, ainsi, détournant continuellement la force des expressions antérieures et la subsumant sous de nouvelles constructions. La distinction entre métaphores conventionnelles, ou collectives, et métaphores individuantes, n’est toutefois pas perdue. Elle représente la frontière entre les expressions socialisantes (collectives) et les expressions qui s’imposent par leur force propre (individuelles). (À cet égard notre modèle a sans aucun doute une dette envers Claude Lévi-Strauss et le chapitre « Universalisation et particularisation » de La Pensée sauvage.) Cela étant dit, l’aspect collectif de la symbolisation s’identifie également avec la culture comme morale ou comme éthique, en relation dialectique avec sa dimension factuelle – voir le chapitre de Clifford Geertz, « Ethos, World View, and the Analysis of Sacred Symbols » dans The Interpretation of cultures (Basic Books, 1973).
Du point de vue épistémologique, L’Invention de la culture s’inscrit dans le modèle habu dont elle entreprend une exploration radicale afin d’en développer les implications. Le chapitre iii présente la succession des implications interconnectées et imbriquées. Au risque de tomber dans le jargon des inévitables références croisées de termes techniques, il les présente « toutes ensemble ».
Les ajouts les plus significatifs au modèle habu consistent d’abord en une clarification des effets de contraste entre symbolisation conventionnelle et différenciatrice. En tant que termes de la dialectique, elles se symbolisent nécessairement l’une l’autre, mais elles le font de façon différente. La symbolisation conventionnelle crée une distinction contrastive entre les symboles eux-mêmes et les choses qu’ils symbolisent. J’appelle contraste contextuel cette distinction, qui différencie les deux modes du point de vue de leur charge idéologique respective. Les symboles différenciateurs assimilent ou englobent ce qu’ils symbolisent. J’appelle « obviation » cet effet qui aboutit toujours à nier la distinction entre les modes, à les chambouler ou à les dériver l’un de l’autre. Ces effets étant réflexifs, c’est-à-dire que le « symbolisé » produit en retour son effet sur ce qui le symbolise, tous les effets symboliques sont mobilisés dans n’importe quel acte de symbolisation. C’est pourquoi le deuxième ajout est que la conscience du symboliseur doit se concentrer sur l’un des modes à chaque moment particulier. En focalisant son attention sur ce mode, il perçoit le mode opposé comme quelque chose de tout à fait différent, une « compulsion » ou une « motivation » internes. Le troisième ajout est que toute « culture » ou toute classe culturelle significative, privilégiera l’une des modalités symboliques comme étant appropriée à l’action des hommes et elle considérera que l’autre est la manifestation du « donné » ou de « l’inné ». Le chapitre iv en étudie la signification pour la structure de la motivation et de la personnalité humaines, et le chapitre v développe un modèle d’intégration et d’évolution culturelles basé sur le contraste contextuel et l’obviation.
Le fonctionnement « épisodique » de la dialectique des sociétés tribales ou « acéphales » est, hormis ses soubassements théoriques, rigoureusement parallèle au modèle de schismogenèse équilibrée, symétrique ou complémentaire, proposé par Gregory Bateson dans l’épilogue de 1936 à la première édition de Naven (La Cérémonie du Naven, Editions de Minuit, Paris, 1971). Cela reflète doublement ma familiarité avec l’œuvre de Bateson et l’admiration qu’elle m’inspire. Moins évidente est la similarité involontaire du contraste établi par Dumont entre homo hierarchicus et homo æqualis et de mes comparaisons entre la société américaine moderne « relativisée » et l’équilibre dialectique des ordres sociaux dans les civilisations anciennes. Concernant la dialectique des classes sociales envisagée ici, je reconnais être surtout redevable à Dumont ainsi qu’à David M. Schneider et Raymond T. Smith pour leur remarquable Class Differences and Sex Roles in American Kinship and Family Structure (Prentice Hall, 1973).
Il est plus difficile de faire remonter à d’autres sources la notion de dynamique culturelle basée sur la médiation des domaines de responsabilité (et d’irresponsabilité) humaine. La question a été plus longuement développée dans mon article « Scientific and Indigenous Papuan Conceptualizations of the Innate » (publié dans Subsistence and Survival, Academic Press 1977) et dans le livre de Marilyn Strathern No Nature, No culture : The Hagen Case (Cambridge University Press, 1980). Dans Lethal Speech : Daribi Myth as Symbolic Obviation (Cornell, 1978), j’étudie les implications radicales de l’obviation comme forme de trope étendu ou « processuel ». Lethal Speech a pour sujet l’obviation, autant que Habu la métaphore. L’Invention de la culture, dans la mesure où ce livre s’intéresse aux relations que ces formes entretiennent avec la convention, devient ainsi le volume central d’une trilogie non préméditée. L’utilisation que je fais du terme « invention » est à mon sens beaucoup plus traditionnelle que l’usage stéréotypé qui en est fait de nos jours à propos des inventions surgies de nulle part, comme celles des hommes des cavernes un jour de chance et autres découvertes accidentelles. Comme l’invention en musique, le terme se réfère à une composante positive et attendue de la vie humaine. Il semble avoir conservé pour une large part sa signification depuis les rhétoriciens romains jusqu’à l’aube de la philosophie moderne. Dans L’Invention dialectique (De Inventione dialectica, 1479), de l’humaniste Rudolphuis Agricola, elle est présentée comme une des « parties » de la dialectique, dont la fonction est de trouver ou de proposer une analogie pour un « propositus » qui pourra être jugé en conclusion, un peu à la manière dont une hypothèse scientifique est soumise au jugement de « l’expérience ».
L’invention étant largement indéterminée pour les philosophes antiques et médiévaux, il a incombé à la vision mécanico-matérialiste du monde, avec son déterminisme newtonien, de la rejeter dans le domaine de « l’accident ». Ceci étant dit, bien sûr, il y a la tentation inévitable de coopter l’accident lui-même (c’est-à-dire l’entropie, la mesure, non de l’aléatoire, s’il vous plaît, mais de notre ignorance !) dans le « système », de repérer dans les études évolutionnistes l’action d’une « nécessité » dans la succession des coups portés à l’aveugle, de jouer au jeu de l’assurance-vie avec les particules subatomiques, d’écrire la grammaire de la métaphore ou le braille de la communication non verbale, ou de programmer des ordinateurs pour écrire des vers blancs (aussi mauvais, à l’occasion, que ceux que les humains savent faire). Mais coopter, ou prédiquer, l’invention et lui accorder un traitement satisfaisant sont deux choses passablement différentes.
Quoi qu’il en soit, il était plutôt inévitable que l’anthropologie des symboles rencontre le « trou noir » de la théorie symbolique moderne, le « symbole négatif », le trope qui produit (ou oblige à inventer) ses propres référents. L’Invention de la culture a paru à peu près au même moment que trois autres tentatives d’exploration, extrêmement différentes, de ce trou noir : Le Symbolisme en général de Dan Sperber, Ritual and Knowledge among the Baktaman de Fredrik Barth, et Histoires de pouvoir de Carlos Castaneda. Pour Sperber, le trou noir n’est pas tant un puits de gravité qu’un nuage de poussière noire. Il est identifié comme l’endroit où cesseÊla référence ; le « savoir » s’atteint à travers la formation d’une métaphore, mais c’est un savoir qui se forge à un niveau personnel, par imitation d’un savoir « encyclopédique » (c’est-à-dire conventionnel) plus répandu. Sperber comprend parfaitement qu’une métaphore est un défi et qu’il faut, comme le diraient les confidents de Castaneda, « gagner soi-même son savoir ». Mais le résultat, à en juger par ses conclusions, relève de la contrefaçon plus que de l’invention. Pour Sperber, l’invention ne peut pas révéler, et de ce fait ne peut pas créer le monde, comme elle le peut pour Piaget, car ce n’est qu’un pauvre pis-aller du « vrai » savoir.
La culture des Baktaman, telle que Barth la présente, est pratiquement à l’opposé de cela. Bien qu’il admette tacitement que le sens se constitue à travers la métaphore, cette dernière, en l’absence totale de présupposés ou d’associations partagés, se construit sur une communauté de sensations – la rosée sur l’herbe, le rouge du fruit du pandanus, et ainsi de suite – dans une sorte de « troc silencieux » de symboles sémiologiques. Les signes conventionnels, loin d’acquérir une valeur d’usage courant à travers la redistribution continue des métaphores, sont absorbés dans le secret de leur formation et le savoir, pour autant qu’il en existe, est accaparé et livré au compte-gouttes aux initiés. Comme les messages radio envoyés entre les trous noirs, ce qui parvient est très limité. Même si l’on accorde à Barth le bénéfice d’un peu d’exagération rhétorique, on ne peut s’empêcher de se demander, devant le vide hermétiquement scellé de cette non-communication égocentrée, de qui les Baktaman croient protéger leurs secrets.
Après tout ce qui a été dit sur le caractère douteux des écrits de Castaneda, on ne peut que leur appliquer la même suspension professionnelle du doute que l’on accorderait à l’ethnographe qui rend compte d’un système exotique de croyances d’Afrique ou d’Êxtrême-Orient. Le modèle, délicatement autonome et dialectique, qu’il présente dans Histoires de pouvoir ressemble à une réponse « bouddhiste » à l’« hindouisme » de la théologie aztèque de Moyucoyani, le dieu qui s’est « inventé lui-même », selon l’étymologie du verbe yucoyo, « inventer », décrite par Miguel León-Portilla. Mais, même si Castaneda avait « inventé » toute cette histoire, la publication en temps opportun de cet exemple d’anthropologie des symboles resterait significative. Car le nagual (le pouvoir, « ce avec quoi l’on ne traite pas »), dans son opposition au tonal (« tout ce qui peut être nommé », la convention), est l’expression la plus nette que nous ayons du symbole négatif. C’est cela qui fait la métaphore mais échappe toujours à son expression. (Et ici, il serait peut-être utile de se rappeler que les cultures méso-américaines partagent avec la culture indienne la distinction d’avoir, chacune de son côté, donné naissance au symbole du zéro, la « quantité négative ».)
J’ai évoqué, non sans un évident parti pris, ces trois textes contemporains de L’Invention de la culture, non pour leur faiblesse ou leur supériorité éventuelles, mais parce que, en dépit de tout ce qui les sépare dans leur approche ou dans leur épistémologie, ils ont exactement la même compréhension des propriétés du symbole négatif. Les différences apparaissent dans ce qu’ils font de ces propriétés et dans la façon dont leur relation aux symboles conventionnels en est affectée. Traiter l’invention comme une symbolisation manquée, la considérer comme un pseudo-savoir, comme le fait Sperber, c’est considérer que le plus puissant des outils n’est que du vent, l’inspiration d’une civilisation fière de son savoir. La traiter, avec Barth, comme un vrai « trou noir » – l’invention qui dévore la convention –, c’est, bien qu’on doive y reconnaître une magnifique démonstration de ce vers quoi tend la symbolisation négative, une forme d’abdication de la situation de l’humain. On pourrait en effet opposer Sperber à Barth comme « l’objectivisme subjectif » au « subjectivisme objectif ».
L’approche dialectique, par contraste, subvertit la subjectivité comme l’objectivité au nom de la médiation. Cette position, que les critiques de ce livre ont trouvée soit follement frustrante soit obscurément séduisante, consiste à poser des affirmations tantôt dangereusement subversives sur le savoir conventionnel et tantôt invraisemblablement positives sur les opérations non conventionnelles. La médiation, telle que Castaneda la pratique, avec ses aventures bizarres parmi les papillons et les shamans acrobatiques, est au service d’un éveil aussi séduisant et aussi peu accessible que le satori zen. L’anthropologie ne vise traditionnellement pas aussi haut, et un petit satori suffit à lui faire grand usage. Mais « suivre les significations produites sous l’ordre du tonal » pose des problèmes qui ne sont pas sans contaminer le style littéraire autant que le modèle.
Revenons donc à la question de savoir comment mes analyses se situent dans le champ du discours théorique : il y a grand danger, compte tenu surtout de l’analyse abstraite de la « culture » qui ouvre le livre, que certains lecteurs veuillent me situer sur un axe idéalisme/pragmatisme. Cependant, de la même façon que les phénoménologues, les ethnométhodologues et certains anthropologues marxistes, j’ai choisi d’éluder ou de contourner cet axe, plutôt que de me positionner par rapport à lui. Cela signifie que, malgré les analogies que l’on pourra trouver avec Alfred Schütz, avec les modèles philosophiques de « construction du réel » ou avec le jugement « synthétique a priori » de Kant, mon travail n’est pas « philosophique » et il ne s’agit pas ici de philosophie. Il fait en réalité l’impasse sur les « questions » ethnocentriques et sur les points d’orientation que la philosophie considère indispensables pour soutenir (et défendre) son idéalisme. Mais cela signifie aussi que, malgré l’importance du mot « production » au chapitre ii, je ne ressens pas d’intérêt pour les mouvements gauchisants qui voudraient faire monter les réalités de la production concrète sur les estrades poussiéreuses du discours universitaire. Les réalités, comme le chapitre iii semble le dire, sont ce que nous en faisons, et non ce qu’elles font de nous ou qu’elles nous font faire.
Enfin, puisqu’il semble bien que les symboles m’intéressent, il s’impose d’essayer de clarifier ce thème rebattu. Comme les derniers chapitres devraient le rendre évident, je n’aspire pas, sauf peut-être conceptuellement, à un « lingage » qui parlerait des symboles, des symboles dans le discours, etc. avec plus d’exactitude, plus de précision, ou de façon plus complète qu’ils ne « parlent d’eux-mêmes ». La constitution d’une science des symboles me paraît aussi peu recommandable que d’autres tentatives donquichottesques de formulation de l’informulable, comme une grammaire de la métaphore ou un dictionnaire absolu. La raison en est que les symboles et les gens existent dans une relation dialectique les uns avec les autres – ils sont le démon qui s’attache à nous comme nous sommes le leur – et la question de savoir si « collectiviser » et « différencier », « généraliser » et « particulariser », sont au final des dispositions symboliques ou humaines devient inextricablement emmêlée dans les rets de la médiation.
Ai-je donc artificiellement exagéré les polarités de la symbolisation humaine en contrastant et en opposant à l’extrême, délibérément, des usages qui ne sont opposés que relativement, et encore de façon discutable ? Bien évidemment, et ce dans l’espoir que cette « imagerie » nous aiderait à mieux voir le paysage, à l’instar des constructions géométriques à peine visibles que Cézanne introduisait dans ses paysages. Ce concerto pour symboles et percussion comporte-t-il trop de notes, comme il a été dit de la musique de Mozart ? Oui, bien sûr, et je préfère écouter Mozart.
Ayant à présent satisfait à la fonction essentielle des introductions, qui est d’expliquer au lecteur ce que le livre n’est pas, nous pourrions aborder la question éternellement « pertinente » de Lénine : que faire ? Une anthropologie véritable, telle que l’envisageaient Kant ou Sartre, est-elle possible ou plus près de se réaliser qu’au moment où j’ai écrit ce livre ? Peut-être. Mais puisque l’anthropologie, comme la plupart des entreprises modernes, a largement elle-même pour objet, la bonne question serait de se demander ce que produirait une anthropologie ainsi idéalement constituée ? (Et la réponse est « davantage d’anthropologie », bien entendu.) Que reste-t-il alors de la possibilité de réaliser un équilibre véritablement dialectique au sein de la société occidentale, d’échapper au gâchis sans fin des bobards idéologiques et des justifications de « la quantité pour la quantité » (à savoir « la mobilisation économique sans autre fin qu’elle-même ») de ce bourbier des « États belligérants » ? Hormis le fait que le problème se règlera de lui-même (et nous pouvons deviner que ce sera terrifiant), la question du progrès global rappelle le sort d’un poète chinois qui vivait à la grande époque assoupie où Confucius et le tao s’étaient chargés des conflits spirituels de la Chine, et où les mandarins se chargeaient du reste : il songeait avec nostalgie, en voyant un immense nuage de poussière s’élever à l’horizon, que c’était « la poussière soulevée par un millier de chars ». Mais il n’en était jamais rien. Nous vivons une époque intéressante.
A l’occasion de la parution en français, tant attendue, de L’Invention de la culture, le Musée du Quai Branly avait organisé le vendredi 12 décembre 2014 une rencontre autour de l’ouvrage avec l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro et le philosophe français Patrice Maniglier. L’enregistrement de cette rencontre est désormais disponible ici.